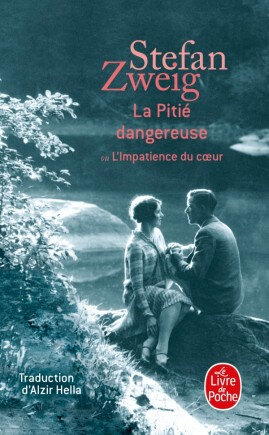Conçue et mise en scène par Judith Depaule, Les Enfants de la terreur, pièce de théâtre contemporaine, a été créée au Théâtre National de Bretagne dans le cadre du Festival Mettre en scène, par la troupe Mabel Octobre. Jouée par six comédiens, une acrobate, un bassiste et une guitariste / chanteuse, qui interprètent une triple partition (textuelle, musicale, et corporelle), Les Enfants de la terreur interroge des zones de non-existence, et met en œuvre un travail de mémoire et de réhabilitation (enquêtes historiques, recherches documentaires), en mélangeant différentes disciplines (théâtre, danse, musique live, chant, lumières, vidéo sous différentes formes, jeu vidéo, marionnettes) et en accordant une place privilégiée au développement numérique, à l'innovation technologique, et à l'écriture contemporaine.
Dans ce spectacle multimédia, Judith Depaule aborde le terrorisme d'extrême-gauche des années 70 par le biais de corps engagés, d'images choc, de musiques rock contestataire et de discours révolutionnaires. Cette création évoque la manière dont la lutte pour la liberté peut engendrer la terreur et questionne les liens entre engagement et démesure, utopie révolutionnaire et destruction. S'appuyant notamment sur des recherches documentaires et des témoignages, la troupe renvoie le public en 1968, suite aux protestations concernant la guerre du Vietnam et aux troubles sociaux à l'échelle mondiale. Dans les trois anciens pays de l'Axe, des organisations d'extrême-gauche ont pris les armes – l'Armée rouge japonaise [ARJ] au Japon, la Fraction Armée Rouge [RAF] en Allemagne, et les Brigades Rouges [BR] en Italie – et ont mené, jusqu'à la fin des années 90, des actions terroristes, principalement au cours des années 70, décennie renommée « de plomb » ou « rouge » – notamment en 1972, année du passage à l'acte pour ces trois organisations : série d'attentats, prise d'otages aux JO de Munich. Les attentats sont reconstitués à chaque fois d'une manière différente afin de rendre l'idée d'un « jeu » dont la nature change mais les règles demeurent identiques, et ont pour fil conducteur la question « comment représenter la violence sur une scène de théâtre ? ». Judith Depaule questionne par le pouvoir du théâtre, au-delà des clichés, la fin des utopies ; et dresse un spectacle sur l'histoire de six militants, six jeunes qui nous racontent leurs désirs, leur rapport à la mort, leur vision de la révolution, leur combat contre l'impérialisme américain au Vietnam, leur soutient au peuple palestinien, leur lutte contre le capitalisme, et leur immersion dans un terrorisme aveugle rompant peu à peu avec les travailleurs. Elle met en avant les actions de ces leaders de ces mouvements, et regroupe par duos des dirigeants emblématiques des trois principales organisations qu'ils ont choisi de suivre (Ulrike Meinhof et Andreas Baader représentent la RAF, Fusako Shigenobu et Kozo Okamoto représentent l'ARJ, et Margherita Cagol et son mari Renato Curcio représentent les BR) ; ces personnes qui ont choisi de rompre avec le passé de leur pays marqué par le fascisme, pour se lancer dans des actions terroristes d'extrême-gauche (l'ARJ commet un attentat à l'aéroport de Lod à Tel-Aviv ; l'organisation Septembre Noir procède à une prise d'otages aux JO de Munich ; la RAF commet cinq attentats meurtriers à la bombe contre des objectifs militaires / policiers / judiciaires et médiatiques dans six villes allemandes ; et les BR enlèvent Hidalgo Macchiarini à Milan). Certaines de ces personnes étaient fils de bourgeois, d'autres issus du prolétariat ; l'un était un fêtard amateur de grosses cylindrées, d'autres des révoltés. Mais tous se sont rangés du même côté, dans un combat pour leur idéologie et une lutte pour leur cause juste. Tous tiennent un discours à la fois politique et humain – comme lorsque les femmes racontent leur renoncement au fondement d'une famille, pour la lutte, pour leur idéologie. Le spectateur est interpellé, convié à comprendre, mais aussi à prendre position. Ce dernier, face à ces révolutionnaires et à leur discours, ne peut que se ranger de leur côté. Nous suivons le chemin parcouru par ces hommes et ces femmes de l’idée à l’idéal puis à l’idéologie, jusqu’à la radicalisation finale.
Mais les années 60/70 sont aussi celles de la révolution des corps, et la chorégraphie du spectacle rend hommage à cette libération corporelle. La répression policière et la violence de l'incarcération y sont jouées. Sur fond de musique rock de l'époque jouée en live – rock expérmiental allemand et japonais en réaction au modèle anglo-saxon, et composée pour le specacle – et de chants révolutionnaires et engagés, les comédiens dansent et bougent leur corps, mimant parfois presque ; toujours avec ce rapport à la révolution et au combat qu'ils mènent pour leur cause. Les corps sont libérés et guerriers, et mis à l'épreuve du combat, de la violence, de la privation, de la peur et de l'enfermement. Même le maniement des armes paraît chorégraphié. Ce spectacle nous transmet le caractère romantique de l'engagement de ces militants révolutionnaires, et nous rappelle que la révolution ne se fait pas au nom des travailleurs, mais qu'elle est l’œuvre des travailleurs eux-mêmes. Les costumes, réalistes, font référence aux années 70 et alternent tenues provocantes de la libération vestimentaire anticonformiste de l'époque, habits du clandestin cherchant à passer inaperçu, et vêtements de circonstance – survêtements sportifs bleus pour les JO, blouses médicales pour les reconstitutions avec maquettes, tenues de forces de l'ordre, etc... .
Dans une résonance actuelle, Les Enfants de la Terreur interroge nos engagements, nos peurs, ainsi que l'impasse du politique ; nous faisant nous remémorer que le combat pour l'émancipation de la classe ouvrière n'est pas achevée. Cependant, il ne s'agit pas que d'un théâtre historique. Judith Depaule, sans l'exprimer ouvertement, nous amène à repenser notre époque actuelle. En effet, ces militants qui acceptent de perdre leur vie pour faire avancer une cause qu'ils jugent « juste », ne représentent-ils que des militants du passé ? Cette société bloquée des années 60, où les jeunes étouffent et où les autorités demeurant sourdes contribuent à la faillite morale, n'est-elle valable que pour les années 60 ? Dans cette œuvre théâtrale et politique, des questions, toujours aussi actuelles, sont soulevées : s’indigner ne change pas le monde, mais comment agir sans courir le risque de la violence face à la répression ? Changer le monde, le rendre meilleur, faire justice, mais comment et à quel prix ?

« - On la trouve, et on la vit !
- Dans tout ce qui nuit.
- Opprime, détruit !
- Dans les appareils de contrôle des classes dominantes !
- Dans la propagande !
- Dans le lavage de cerveau, dans les médias !
- Dans la publicité !
- Dans la consommation et les lois du marché !
- Dans la cogestion !
- Dans l'opportunisme !
- Dans le dogmatisme !
- Dans la domination !
- Dans le paternalisme !
- Dans la brutalité...
- Dans le dogme de la non-violence. »
2016. Les Enfants de la terreur, mise en scène de Judith Depaule, avec :
- Anne-Sophie Sterck
- Baptiste Amann
- Cécile Fradet, acrobate
- David Botbol
- Eryck Abecassis, synthèse modulaire et basse
- Jonathan Heckel
- Judith Depaule
- Marie Félix
- Mell, guitare électrique et chant
Illustrations : C. Richard
Extrait : Les Enfants de la terreur